En 1985, l’historien Barry Mehler a fait un rêve. Ses recherches l’entraînaient profondément dans le territoire trouble de l’extrême droite universitaire. Alors qu’il travaillait, il a constaté que sa vie éveillée commençait à s’imprégner dans son subconscient, colorant son sommeil. Dans son rêve, son fils, alors âgé de deux ans, est coincé dans une voiture en fuite qui dévale une pente. « La circulation se fait dans les deux sens, et je suis au milieu de la route, agitant désespérément les mains pour essayer d’arrêter le flux, afin de sauver la vie de mon fils », me raconte-t-il. « C’est une métaphore de ce que je ressentais. »
Mehler s’était penché sur ce qu’il était advenu après la Seconde Guerre mondiale des scientifiques qui, pendant le conflit, avaient collaboré avec les nazis, étaient eugénistes ou partageaient leur vision raciale du monde. « J’étais vraiment concentré sur la continuité idéologique entre les anciens et les nouveaux », dit-il. Il a appris que la crainte d’une sorte de menace pour la « race blanche » était toujours vivante dans certains cercles intellectuels, et qu’il existait un réseau bien coordonné de personnes qui tentaient de ramener ces idéologies dans les milieux universitaires et politiques dominants.
Mehler, qui est juif, a naturellement trouvé tout cela inquiétant. Il a immédiatement vu des parallèles entre le réseau d’intellectuels d’extrême droite et la manière rapide et dévastatrice dont la recherche eugénique avait été utilisée dans l’Allemagne nazie, le terrifiant avec la possibilité que les atrocités brutales du passé puissent se reproduire. Il était impossible de ne pas imaginer que le cœur idéologique qui les sous-tendait battait encore. « J’avais l’impression d’essayer désespérément d’empêcher que cela ne se reproduise », dit-il. « Je pensais que nous nous dirigions vers un nouveau génocide ». Sa voix trahit une anxiété que la stabilité politique, même dans les démocraties les plus fortes, se trouve sur un précipice.
Sa peur est quelque chose que j’ai commencé à partager. Mehler a dit de ses proches qui ont survécu à l’Holocauste : « Ils sont préparés à ce que les choses cessent d’être normales très rapidement. » Ses mots résonnent dans mes oreilles. Je n’ai jamais imaginé que je pourrais vivre des moments qui pourraient aussi me faire ressentir cela, qui pourraient me laisser si anxieux pour l’avenir. Pourtant, je suis là.
J’ai grandi dans le sud-est de Londres – dans un foyer indien-punjabi – non loin de l’endroit où l’adolescent noir Stephen Lawrence a été tué par des voyous racistes blancs en 1993 alors qu’il attendait un bus. Il n’avait que cinq ans de plus que moi, et son meurtre a marqué ma génération. L’ancienne librairie du British National Party se trouvait dans la même ville que mon école secondaire. Le racisme était la toile de fond de mon adolescence. Mais ensuite, pendant un bref instant, les choses ont semblé pouvoir changer. Mon fils est né il y a cinq ans, alors que la société britannique semblait embrasser la diversité et le multiculturalisme. Barack Obama était président des États-Unis. Je rêvais que mon bébé pourrait grandir dans un monde meilleur que le mien, peut-être même un monde post-racial.
Les choses ont cessé d’être normales. Les groupes d’extrême droite et anti-immigrés sont redevenus visibles et puissants en Europe et aux États-Unis. En Pologne, des nationalistes défilent sous le slogan « Pologne pure, Pologne blanche ». En Italie, un dirigeant de droite gagne en popularité en promettant d’expulser les immigrants illégaux et de tourner le dos aux réfugiés. Les nationalistes blancs considèrent la Russie de Vladimir Poutine comme un défenseur des valeurs « traditionnelles ».

Lors des élections fédérales allemandes de 2017, Alternative für Deutschland a remporté plus de 12 % des voix. L’année dernière, le lanceur d’alerte Chris Wylie a affirmé que Cambridge Analytica, connue pour être étroitement liée à l’ancien stratège en chef de Donald Trump, Steve Bannon, utilisait des idées de différence raciale ciblant les Afro-Américains pour trouver comment susciter le soutien des conservateurs blancs lors des élections de mi-mandat de 2014. Depuis qu’il a quitté la Maison Blanche en 2017, Bannon est devenu une figure clé des mouvements d’extrême droite européens, et espère désormais ouvrir une académie « alt-right » dans un monastère italien. Cela fait écho aux « racistes scientifiques » après la Seconde Guerre mondiale, qui, lorsqu’ils ne parvenaient pas à trouver des avenues dans le milieu universitaire traditionnel, créaient simplement leurs propres espaces et publications. La différence aujourd’hui est que, en partie à cause d’Internet, il est beaucoup plus facile pour eux d’attirer des financements et des soutiens. En France en 2018, Bannon a dit aux nationalistes d’extrême droite : « Laissez-les vous traiter de racistes, laissez-les vous traiter de xénophobes, laissez-les vous traiter de nativistes. Portez-le comme un badge d’honneur. »
¶
J’ai passé les dernières années à enquêter sur la croissance tumorale de cette marque de racisme intellectuel. Pas les voyous racistes qui nous affrontent au vu et au su de tous, mais ceux qui sont bien éduqués et en costume, ceux qui ont le pouvoir. Et comme Mehler, j’ai rencontré des réseaux étroits, y compris des universitaires des plus grandes universités du monde, qui ont cherché à façonner les débats publics sur la race et l’immigration, en poussant doucement vers l’acceptabilité l’idée que les « étrangers » sont par nature une menace parce que nous sommes fondamentalement différents.
Au sein de cette cabale, il y a ceux qui se tournent vers la science pour étayer leurs opinions politiques. Certains se décrivent comme des « réalistes de la race », reflétant la façon dont ils considèrent la vérité scientifique comme étant de leur côté (et parce que se qualifier de raciste est encore peu appétissant, même pour la plupart des racistes). Pour eux, il existe des différences biologiques innées entre les groupes de population, qui font que des nations entières, par exemple, sont naturellement plus intelligentes que d’autres. Ces « faits biologiques » expliquent parfaitement le cours de l’histoire et les inégalités d’aujourd’hui.
Ces prétendus savants sont glissants – ils utilisent des euphémismes, des graphiques d’apparence scientifique et des arguments obscurs. Surfant sur la vague du populisme dans le monde et exploitant l’internet pour communiquer et publier, ils sont aussi devenus plus audacieux. Mais comme Mehler me le rappelle, ils ne sont pas nouveaux.
C’est une histoire qui remonte à la naissance de la science moderne. La race nous semble si tangible aujourd’hui que nous avons oublié que la classification raciale a toujours été assez arbitraire. Au 18e siècle, les scientifiques européens ont tamisé les gens en types humains, inventant des catégories telles que le caucasien, mais avec peu de connaissances sur la façon dont les autres vivaient. C’est pourquoi, au cours des siècles qui ont suivi, personne n’a jamais pu définir avec précision ce que nous appelons aujourd’hui « race ». Certains disaient qu’il y avait trois types, d’autres quatre, cinq ou plus, voire des centaines.
Ce n’est que vers la fin du 20e siècle que les données génétiques ont révélé que la variation humaine que nous observons n’est pas une question de types durs mais de petites et subtiles gradations, chaque communauté locale se fondant dans la suivante. Jusqu’à 95 % de la différence génétique de notre espèce se situe au sein des principaux groupes de population, et non entre eux. Statistiquement, cela signifie que, même si je ne ressemble en rien à la femme britannique blanche qui vit à l’étage, il est possible que j’aie plus en commun génétiquement avec elle qu’avec ma voisine d’origine indienne.
Nous ne pouvons pas cerner la race biologiquement, car elle existe comme une image dans les nuages. Lorsque nous nous définissons par la couleur, nos yeux ne considèrent pas que les variantes génétiques pour la peau claire se trouvent non seulement en Europe et en Asie de l’Est, mais aussi dans certaines des plus anciennes sociétés humaines en Afrique. Les premiers chasseurs-cueilleurs d’Europe avaient la peau foncée et les yeux bleus. Il n’y a pas de gène qui existe chez tous les membres d’un groupe racial et pas chez un autre. Nous sommes tous, chacun d’entre nous, le produit de migrations anciennes et récentes. Nous avons toujours été ensemble dans le melting-pot.

La race est la contre-proposition. Dans l’histoire de la science de la race, des lignes ont été tracées à travers le monde de nombreuses façons différentes. Et la signification de ces lignes a changé selon les époques. Au 19e siècle, un scientifique européen n’avait rien d’exceptionnel à penser que les Blancs étaient biologiquement supérieurs à tous les autres, tout comme il pouvait supposer que les femmes étaient intellectuellement inférieures. Dans la hiérarchie du pouvoir, les hommes blancs d’origine européenne étaient assis au sommet, et ils ont commodément écrit l’histoire scientifique de l’espèce humaine autour de cette hypothèse.
Parce que la science de la race a toujours été intrinsèquement politique, nous ne devrions pas être surpris que des penseurs éminents aient utilisé la science pour défendre l’esclavage, le colonialisme, la ségrégation et le génocide. Ils ont imaginé que seule l’Europe aurait pu être le berceau de la science moderne, que seuls les Britanniques auraient pu construire un chemin de fer en Inde. Certains imaginent encore que les Européens blancs possèdent un ensemble unique de qualités génétiques qui les ont propulsés vers la domination économique. Ils croient, comme le président français Nicolas Sarkozy l’a dit en 2007, que « le drame de l’Afrique est que l’Africain n’est pas pleinement entré dans l’histoire… il n’y a pas de place pour l’effort humain ni pour l’idée de progrès ».
¶
Nous n’avons pas laissé le passé derrière nous. Il existe une ligne directe entre les anciennes idéologies et la rhétorique de la nouvelle. Mehler était une personne qui l’avait compris car c’était la ligne qu’il traçait soigneusement.
Après la deuxième guerre mondiale, la science des races est progressivement devenue taboue. Mais l’une des personnes clés à avoir gardé intacte sa vision raciale du monde, a appris Mehler, était un personnage de l’ombre appelé Roger Pearson, qui a aujourd’hui 90 ans (il a refusé de me parler). Pearson avait été officier dans l’armée indienne britannique puis, dans les années 1950, il a travaillé comme directeur général d’un groupe de jardins de thé dans ce qu’on appelait alors le Pakistan oriental, aujourd’hui le Bangladesh. C’est à cette époque qu’il a commencé à publier des bulletins d’information, imprimés en Inde, explorant les questions de race, de science et d’immigration.
Très rapidement, dit Mehler, Pearson s’est mis en relation avec des penseurs partageant les mêmes idées dans le monde entier. « Il commençait à organiser institutionnellement les restes des universitaires d’avant-guerre qui travaillaient sur l’eugénisme et la race. La guerre avait perturbé toutes leurs carrières, et après la guerre, ils essayaient de se rétablir. » Parmi eux figurait le scientifique nazi spécialiste de la race Otmar Freiherr von Verschuer, qui, avant la fin de la guerre, avait mené des expériences sur les parties du corps d’enfants assassinés qui lui avaient été envoyées d’Auschwitz.
L’une des publications de Pearson, le Northlander, se décrivait comme une revue mensuelle des « affaires pan-nordiques », ce qui signifiait des sujets d’intérêt pour les Européens blancs du Nord. Sa première édition en 1958 se plaignait des enfants illégitimes nés en raison du stationnement de troupes « noires » en Allemagne après la guerre, et des immigrants arrivant des Antilles en Grande-Bretagne. « La Grande-Bretagne résonne au son et à la vue des peuples primitifs et des rythmes de la jungle », avertit Pearson. « Pourquoi ne pouvons-nous pas voir la pourriture qui se produit en Grande-Bretagne même ? »
Ses bulletins d’information reposaient sur la capacité à atteindre des figures marginales du monde entier, des personnes dont les opinions étaient généralement inacceptables dans les sociétés dans lesquelles elles vivaient. En l’espace de quelques décennies, Pearson s’est retrouvé à Washington DC, où il a également créé des publications, notamment le Journal of Indo-European Studies en 1973 et le Journal of Social, Political and Economic Studies en 1975. En avril 1982, il reçoit de la Maison Blanche une lettre portant la signature du président Ronald Reagan, qui le félicite d’avoir encouragé les universitaires qui soutiennent « une économie de libre entreprise, une politique étrangère ferme et cohérente et une défense nationale forte ». Pearson s’est servi de cet appui pour collecter des fonds et obtenir d’autres soutiens.
L’enquête sur les scientifiques raciaux a été menée à la même époque par Keith Hurt, un fonctionnaire à la voix douce, également à Washington, qui a été étonné de trouver « des réseaux et des associations de personnes qui tentaient de maintenir en vie un ensemble d’idées que j’avais associées au moins au mouvement des droits civiques » aux États-Unis, « et qui remontaient au mouvement eugénique au début du siècle dernier. Ces idées étaient encore développées, promulguées et promues de manière discrète. »
« Ils avaient leurs propres journaux, leurs propres maisons d’édition. Ils pouvaient revoir et commenter le travail des autres », me dit Mehler. « C’était presque comme découvrir tout ce petit monde à l’intérieur du monde universitaire. » C’étaient les personnes qui maintenaient le racisme scientifique en vie.
En mai 1988, Mehler et Hurt ont publié un article dans The Nation, un hebdomadaire américain progressiste, sur un professeur de psychologie de l’éducation à l’Université de Northern Iowa appelé Ralph Scott. Leur rapport affirmait que Scott avait utilisé des fonds fournis par un riche ségrégationniste sous un pseudonyme en 1976 et 1977 pour organiser une campagne nationale contre le busing (le busing était un moyen de déségrégation des écoles en transportant les enfants d’une région à une autre). Pourtant, en 1985, l’administration Reagan nomme Scott à la présidence du comité consultatif de l’Iowa auprès de la Commission américaine des droits civils, un organe chargé de faire appliquer la législation antidiscrimination. Même après avoir pris ses fonctions influentes, Scott écrivait pour le journal de Pearson.
Pour ceux qui sont aux extrêmes politiques, c’est un jeu d’attente. S’ils peuvent survivre et maintenir leurs réseaux, ce n’est qu’une question de temps avant qu’un point d’entrée ne s’ouvre à nouveau. Le public a peut-être supposé que le racisme scientifique était mort, mais les racistes ont toujours été actifs sous le radar. Dans The Bell Curve (1994), un best-seller notoire, le politologue américain Charles Murray et le psychologue Richard Herrnstein suggéraient que les Noirs américains étaient moins intelligents que les Blancs et les Asiatiques. Une critique parue dans la New York Review of Books a fait remarquer qu’ils faisaient référence à cinq articles de Mankind Quarterly, une revue cofondée par Pearson et Von Verschuer ; ils ont cité pas moins de 17 chercheurs qui avaient contribué à cette revue. Bien que The Bell Curve ait été largement critiqué (un article de American Behavioral Scientist l’a qualifié d' »idéologie fasciste »), Scientific American a noté en 2017 que Murray bénéficiait d’une « résurgence malheureuse ». Faisant face à des manifestants, il a été invité à donner des conférences sur les campus universitaires à travers les États-Unis.
Le Mankind Quarterly de Pearson reste imprimé, publié par un thinktank se faisant appeler l’Ulster Institute for Social Research, et rejoint par une flopée de publications plus récentes – dont certaines en ligne – examinant des sujets similaires. Parmi les articles récents de la revue figurent « le racisme dans un monde où les différences raciales existent » et les liens entre « le rayonnement solaire et le QI ». L’immigration est un thème récurrent.

Dans un entretien par courriel avec son rédacteur en chef actuel, un biochimiste appelé Gerhard Meisenberg travaillant en Dominique, on m’a dit sans ambages qu’il existe des différences raciales en matière d’intelligence. « Les juifs ont tendance à très bien s’en sortir, les Chinois et les Japonais assez bien, et les Noirs et les Hispaniques moins bien. Les différences sont faibles, mais l’explication la plus parcimonieuse est qu’une grande partie, voire la majorité, de ces différences sont dues aux gènes », écrit-il. Meisenberg, comme d’autres membres de ce réseau, condamne ceux qui ne sont pas d’accord – en substance, l’establishment scientifique dominant – comme des négateurs irrationnels de la science aveuglés par le politiquement correct.
« Je pense que ce que nous vivons maintenant est un environnement beaucoup plus menaçant », me dit Hurt. « Nous sommes dans une situation bien pire qu’il y a quelques décennies ». En ligne, ces « réalistes de la race » font preuve d’un acharnement féroce. Le philosophe canadien autoproclamé Stefan Molyneux, dont la chaîne YouTube compte près d’un million d’abonnés, livre des monologues rhétoriques si longs qu’ils semblent conçus pour broyer les téléspectateurs jusqu’à la soumission. « Mère Nature est le raciste », a-t-il déclaré. « Je ne fais qu’éclairer la situation. » Parmi les anciens invités de son émission figurent l’ancienne chroniqueuse Katie Hopkins et l’auteur à succès Jordan Peterson.
Ce qui est inquiétant, c’est que les penseurs qui fournissent le matériel brandi en ligne ont commencé à affirmer leur présence dans d’autres espaces plus crédibles. Au début du mois, Noah Carl, un spécialiste des sciences sociales formé à Oxford, a vu sa prestigieuse bourse du St Edmund’s College, à Cambridge, supprimée après qu’une enquête a confirmé qu’il avait collaboré « avec un certain nombre d’individus connus pour leurs opinions extrémistes ». Collaborateur de Mankind Quarterly, Carl avait soutenu dans une autre publication que, dans l’intérêt de la liberté d’expression, il devait pouvoir dire que les gènes pouvaient « contribuer aux différences psychologiques entre les populations humaines ». Selon une déclaration publiée par son collège, ses activités de recherche et ses liens « ont fait preuve d’une mauvaise érudition, ont promu des opinions d’extrême droite et ont incité à la haine raciale et religieuse ».
Les rédacteurs de Mankind Quarterly, qui a été qualifié de « journal de la suprématie blanche », ont commencé à affirmer leur présence dans d’autres publications scientifiques plus largement reconnues. Le rédacteur en chef adjoint Richard Lynn siège aujourd’hui au comité consultatif éditorial de Personality and Individual Differences, produit par Elsevier, l’un des plus grands éditeurs scientifiques au monde, qui compte le Lancet parmi ses titres. En 2017, Lynn et Meisenberg figuraient tous deux sur la liste du comité éditorial d’Intelligence, une revue de psychologie également publiée par Elsevier.
Fin 2017, le rédacteur en chef d’Intelligence m’a dit que leur présence dans sa revue reflétait son « engagement envers la liberté académique ». Pourtant, après mes demandes de renseignements auprès de lui et d’Elsevier, j’ai découvert que Lynn et Meisenberg avaient été discrètement retirés du comité éditorial à la fin de 2018.
Ce qui était autrefois inacceptable est en train de prendre pied sous la bannière de la « liberté académique » et de la « diversité d’opinion ». Ceux qui, au sein du monde universitaire, auraient pu autrefois garder pour eux des opinions politiques controversées sortent en rampant du bois. Ces dernières années, la revue Nature a même, dans des éditoriaux, invité les scientifiques à la prudence, les mettant en garde contre la montée d’extrémistes cherchant à abuser de leurs résultats.
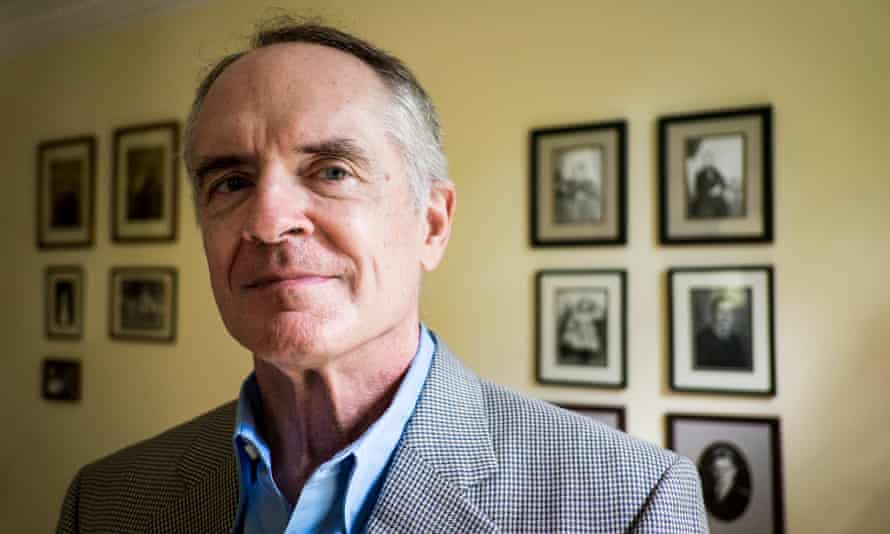
Un contributeur de Mankind Quarterly qui est devenu une figure majeure du mouvement suprémaciste blanc est Jared Taylor, diplômé de Yale, qui a fondé le magazine American Renaissance en 1990. Une phrase utilisée par Taylor pour défendre la ségrégation raciale, empruntée au zoologiste Raymond Hall écrivant dans le premier numéro de Mankind Quarterly, est que « deux sous-espèces de la même espèce ne se rencontrent pas dans la même zone géographique ».
Les conférences de la Fondation American Renaissance de Taylor ont été décrites par le défunt anthropologue américain Robert Wald Sussman comme « un lieu de rassemblement pour les suprématistes blancs, les nationalistes blancs, les séparatistes blancs, les néo-nazis, les membres du Ku Klux Klan, les négationnistes et les eugénistes ». Les participants masculins devaient porter des costumes d’affaires, afin de se démarquer de l’image de voyou que la plupart des gens associent aux racistes. Pourtant, un visiteur d’une réunion a rapporté qu’ils n’ont pas « hésité à utiliser des termes tels que ‘nègre’ et ‘chink' ».
Pour Hurt, il est clair que la science de la race qui a prospéré en Europe et aux États-Unis au début du 20e siècle, se manifestant de manière plus dévastatrice dans « l’hygiène raciale » nazie, avait survécu à la fin de celui-ci et au-delà. « L’élection de Trump a rendu impossible pour beaucoup de gens de ne plus négliger ces choses », dit-il.
Auparavant, il y avait la toile de fond de l’esclavage et du colonialisme, puis ce fut l’immigration et la ségrégation, et maintenant c’est l’agenda de la droite de notre époque. Le nativisme reste un problème, mais il y a aussi un retour de bâton contre les efforts accrus pour promouvoir l’égalité raciale dans les sociétés multiculturelles. Pour ceux qui ont une idéologie politique, la « science » n’est qu’un moyen de se projeter en tant qu’érudits et objectifs.
« Pourquoi avons-nous encore une science raciale, étant donné tout ce qui s’est passé au 20e siècle ? » demande l’anthropologue américain Jonathan Marks, qui s’est efforcé de combattre le racisme dans le milieu universitaire. Il répond à sa propre question : « Parce que c’est une question politique importante. Et il existe des forces puissantes à droite qui financent la recherche sur l’étude des différences humaines dans le but d’établir ces différences comme base des inégalités. »
Un thème commun aux « réalistes raciaux » d’aujourd’hui est leur conviction qu’en raison de l’existence de différences raciales biologiques, les programmes de diversité et d’égalité des chances – conçus pour rendre la société plus juste – sont voués à l’échec. Si un monde égalitaire ne se forge pas assez rapidement, c’est en raison d’un obstacle naturel permanent créé par le fait que, au fond, nous ne sommes pas les mêmes. « Nous avons ici deux sophismes imbriqués », poursuit Marks. La première est que l’espèce humaine se présente sous la forme d’un petit nombre de races distinctes, chacune ayant ses propres caractéristiques. « La seconde est l’idée qu’il existe des explications innées à l’inégalité politique et économique. Ce que vous dites, c’est que l’inégalité existe, mais qu’elle ne représente pas une injustice historique. Ces types essaient de manipuler la science pour construire des frontières imaginaires au progrès social. »
Jusqu’à sa mort en 2012, l’une des figures les plus importantes de ce réseau « réaliste racial » était le psychologue canadien John Philippe Rushton, dont le nom est encore régulièrement cité dans des publications comme Mankind Quarterly. Le Globe and Mail, l’un des journaux les plus lus au Canada, lui a consacré une notice nécrologique élogieuse, bien qu’il soit connu pour avoir affirmé que la taille du cerveau et des organes génitaux était inversement proportionnelle, ce qui faisait des Noirs, selon lui, des personnes mieux dotées mais moins intelligentes que les Blancs. Rushton estimait que « The Bell Curve n’allait pas assez loin » ; ses travaux ont été présentés dans l’émission de Stefan Molyneux.
Lorsque le livre de Rushton, Race, Evolution and Behaviour, a été publié en 1995, le psychologue David Barash a été ému d’écrire dans une critique : « La mauvaise science et les préjugés raciaux virulents dégoulinent comme du pus de presque chaque page de ce livre méprisable ». Rushton avait rassemblé des bribes de preuves peu fiables dans « le pieux espoir qu’en combinant de nombreux petits étrons de données diversement entachées, on puisse obtenir un résultat valable ». En réalité, écrit Barash, « le résultat est simplement un tas de merde plus grand que la moyenne ». En 2019, Rushton reste une icône intellectuelle pour les « race realists » et pour les membres de la « alt-right ».
Laisser un commentaire